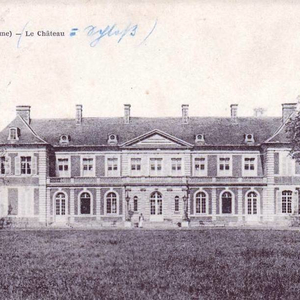Thiepval et ses légendes
Que de légendes n'a-t-on pas édifiées autour de Thiepval, la forteresse village, dont le nom revient si souvent dans les communiqués britanniques ?
Dès l'invasion de la région du nord, les imaginations se sont données libre parcours, et l'on nous a bâti un roman feuilleton d'une fantaisie à rendre jaloux l'auteur de "Zigomar". On nous a parlé d'un châtelain de souche allemande qui, longtemps avant la guerre, aurait fait exécuter dans son château, et dans son parc, des travaux formidables en béton armé ; de centaines de milliers de kilogrammes de ciment, transporté de la petite gare de Beaucourt-Mamel ; d'équipes d'ouvriers étrangers venues des usines Krupp, qui travaillaient jour et nuit à de grands travaux de terrassement et de bétonnage ; d'immenses quantités d'obus emmagasinés dans de vastes souterrains ; de visites fréquentes de personnages mystérieux venant dans de grandes automobiles de marques allemandes, pour surveiller les travaux, et pour tenir des conciliabules avec le propriétaire du château. Bref, il était entendu que les Boches préparaient déjà en 1913 leurs positions stratégiques dans la Somme et prenaient leurs dispositions pour s'arrêter sur la ligne dont Thiepval devait être une des "pierres angulaires". Vraiment, c'est beaucoup d'imagination.
[…] Le château, construit en 1725, était une grande et belle construction de deux étages, avec, sur sa façade principale, un joli balcon protégé par une balustrade en pierre, composée de 180 piliers. […]
L'ancien propriétaire du château était le maire de la commune, le comte Jacques de Breda, qui le tenait de son père. M. de Breda, décédé au commencement de cette année, n'avait certainement rien d'Allemand ni d'Autrichien. Il était bien Français de race, ainsi que Mme de Breda, et lorsqu'en 1912 il vendit son château et ses terres de Thiepval, pour la somme de six cent mille francs, ce fut à un très honorable industriel parisien, M. Henri Portier pour le nommer, ingénieur des mines, de l'École centrale, officier de la Légion d'honneur, administrateur d'une des plus grandes mines de charbon du Nord, et, pendant plusieurs années, officier de réserve de l'armée française.
Voilà pour le châtelain sur le compte de qui on a fait courir tant d'histoires absurdes. Voyons maintenant la châtelaine, qui, d'après la légende populaire, était une Autrichienne. Née Bonnel, et d'une famille honorablement connue depuis plusieurs générations dans le Cambrésis, Mme Portier est tout ce qu'il y a de plus française. Elle a un jeune fils qui va prochainement partir avec sa classe.
M. Portier, dès qu'il eut pris possession de son château, fit venir de Paris un architecte distingué, M. Louis Perin, et ce fut sur les plans de ce technicien que le vieux château seigneurial fut transformé en une demeure somptueuse. M. Henri Portier a dépensé à cette transformation beaucoup d'argent.
Les travaux ont été exécutés par un entrepreneur de Paris, qui, naturellement, a fait venir ses ouvriers. Ces ouvriers, "étrangers"… à la région, pouvaient bien parler un peu argot entre eux, mais ils ne savaient pas un traître mot d'allemand. Il ne fallait pas songer à utiliser des ouvriers de campagne pour un travail de cette importance. Cependant, pour aider dans les travaux, M. Henri Portier a employé un entrepreneur de maçonnerie d'Albert, M. Duchateau.
Ce fut seulement en juin 1914 que M. Portier et sa famille purent s'installer dans leur château. Quatre mois plus tard, cette belle habitation n'était plus qu'un amas de ruines pulvérisées par les obus de l'artillerie française.
[…] Il paraît que lorsque le général allemand est arrivé, il a demandé immédiatement à visiter les caves du château. Lorsque, avec son état-major, il est entré dans la grande cave sous le château, il s'est exclamé "Comment ! C'est tout ? Ce n'est pas possible ! Il doit y avoir d'autres caves que celle-là ?".
C'est précisément cette question de caves, de passages souterrains, sous le château, dont on a tant parlé, qui intrigue M. Portier, ainsi que son architecte. Lorsque ce dernier est venu examiner les assises du château, il les a trouvées solidement bâties dans la craie, ou "marne", mais il n'a trouvé aucune trace de passages souterrains sous le château, ni sous le parc, où l'on a exécuté des forages pour faire des "pertes" d'eaux ménagères.
M. le comte de Breda, l'ancien propriétaire, qui était un lettré et s'intéressait à l'histoire de sa propriété, avait vaguement entendu parler de souterrains qui, d'après la légende populaire, existaient sous les ruines, depuis longtemps disparues, du vieux château féodal, mais il n'y attachait pas autrement d'importance.
D'après la légende, ces anciens passages souterrains très vastes conduisaient des caves du vieux château féodal jusque dans les marais de Beaucourt, à 60 ou 70 mètres en contrebas, mais ils avaient été bouchés depuis deux ou trois siècles pour empêcher les enfants du village de se perdre dans ces dangereux labyrinthes.
M. Portier, ainsi que son architecte, sont absolument persuadés qu'il n'existait pas de souterrains sous le château de Thiepval. Leur bonne foi n'est certes pas douteuse, mais ils peuvent se tromper. Il est très admissible, en effet, que de vastes souterrains existent sous le plateau de Thiepval, et que leur existence fût connue de l'état-major allemand. Le signataire de ces lignes connaît à fond toute la contrée, pour l'avoir parcourue dans tous les sens pendant quinze ans. Aussi a-t-il pu constater que tout le pays, depuis Doullens jusqu'à Bray, Combles, et Albert, porte les traces évidentes de ces profondes érosions, de ces fissures qui sont des anciens lits de fleuves préhistoriques, et dont on peut encore suivre les rives successives par les nombreux "rideaux" qui, pour un œil quelque peu exercé, indiquent les échelles successives de la baisse des eaux.
[…] Dans beaucoup de villages, les passages souterrains ont été bouchés depuis des siècles, et il n'en reste plus que la légende. C'est probablement ce qui est arrivé pour Thiepval.
Mais que les Allemands aient connu l'existence de ces souterrains, cela n'est pas douteux. De nombreux touristes allemands ayant maintes fois exploré la cité souterraine de Naours, ainsi que les cavernes de Béhancourt, quoi d'étonnant à ce qu'ils aient été mis au courant de la légende de Thiepval ! Mais si, comme on l'affirme, ils ont construit dans la craie, à trente mètres de profondeur, trois étages de vastes chambrées, reliés, entre eux par des ascenseurs, pour abriter leurs grosses pièces qui bombardent toujours nos villages de l'arrière, cela ne veut pas dire qu'ils aient pu, pour cela, mettre à profit les anciens passages souterrains de la légende.
Maurice Roubaret