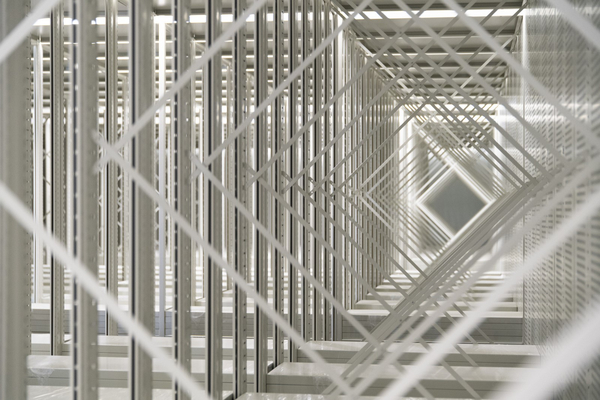C’est à Amettes, petit village blotti dans la petite vallée de la Nave que naît, le 27 mars 1748, le saint Benoît-Joseph Labre : il est le fils de Jean-Baptiste Labre et d’Anne-Barbe Grandsir et l’aîné de quinze enfants.Benoît-Joseph Labre parfait son éducation religieuse et prépare son entrée au séminaire dès l’âge de douze ans auprès de son oncle, curé d’Érin. Ayant renoncé à la prêtrise, il est dans un premier temps refusé par le monastère cistercien de La Trappe et de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil. Il prend finalement l’habit religieux en 1769 à l’abbaye de Sept-Fonds (Allier). Il la quitte quand il tombe malade. Commencent alors sept années d’errance. Benoît-Joseph choisit une vie de mendiant et de pèlerin allant de sanctuaire en sanctuaire. Il parcourt 30 000 km à pied en treize années et donne le produit de ses quêtes aux pauvres. Devenu membre du Tiers-Ordre franciscain, il fait vœu de ne pas se laver par mortification. Il meurt à Rome en 1783, à l’âge de 35 ans, Canonisé en 1881, ses reliques reposent principalement à Amettes, à Marçay (Vienne) et à Rome.Amettes porte encore de nombreuses traces de l’existence du saint. Sur le chemin en pente qui mène à sa maison natale, un chemin de croix daté de 1879 avec quatorze grandes stations en pierre réalisées par G. Pattein et un calvaire invitent au recueillement. Sur l’emplacement de l’ancienne grange a été bâtie une chapelle.L’église Saint-Sulpice édifiée au XVIe siècle dans le style gothique tardif, est agrandie au XIXe siècle pour faire face à l’affluence de pèlerins. Elle renferme de nombreux témoignages de la vie de saint Benoît Joseph Labre, surnommé le « Vagabond de Dieu ». Le saint a été baptisé le 27 mars 1748 sur les fonts baptismaux. Dans une chapelle, sied une grande châsse vitrée contenant la paillasse sur laquelle il est décédé. Les verrières de l’abside rappellent quant à elles quelques évènements de sa vie.Tous les ans, fin août-début septembre, une neuvaine est organisée en l’honneur du saint. Située sur la Via Francigena, chemin de pèlerinage de Canterbury à Rome, Amettes accueille à cette occasion de nombreux pèlerins.L’imagerie populaire, vecteur du développement du culte de Saint-Benoît-Joseph LabreLes premières images pieuses sont imprimées au XIVe siècle et représentent la Vierge Marie, Jésus ou les Saints. Au XVIIIe siècle, l’émergence de l’imagerie populaire participe à favoriser le culte des saints auprès du peuple et à renforcer la doctrine catholique dans le contexte du développement des idées des Lumières. La production d’images pieuses connaît un essor important au XIXe siècle avec l’évolution des techniques d’impression comme la lithographie, mais aussi grâce à la constitution de nombreuses maisons d’édition qui vendent la production des graveurs. Elles sont ainsi produites en série et achetées par les fidèles dont la volonté est de garder un souvenir des cérémonies religieuses : baptême, première communion, confirmation, mariage, décès. Celles dédiées aux Saints peuvent être utilisées appliquées sur le corps des malades dans l’espoir d’un miracle.Suite au décès de Saint-Benoît-Joseph Labre, on assiste à une diffusion immédiate de son culte en France et en Italie. Il décède à Rome le 16 avril 1783 durant la Semaine sainte. Son corps est déposé à l’église Notre-Dame des Monts qu’il fréquente régulièrement durant sa présence à Rome. Si Benoît-Joseph Labre est inconnu de tous, il revêt une certaine popularité après son décès. La foule accourt pour vénérer le nouveau saint et de nombreux miracles surviennent. Ainsi, les reliques mais aussi des portraits de Benoît-Joseph Labre sont demandés de toute part. La rédaction de La Vie de Saint-Benoît Labre est commandée à l’abbé Marconi et est éditée en français en trois éditions successives entre 1784 et 1785. Un Abrégé de la vie du saint paraît en 1783. Ces écrits officiels permettent de diffuser largement auprès des fidèles les épisodes de sa vie.Dans le même temps, de nombreuses images pieuses du saint sont imprimées grâce à la technique de la gravure. Les graveurs italiens s’inspirent de deux portraits peints de Benoît-Joseph Labre. L’un, réalisé de son vivant par André Bley en 1777, aujourd’hui conservé au musée des Franciscains à Rome et le second, réalisé en 1795 par Antonio Cavallucci sous les traits du prophète Élie, conservé au musée des beaux-arts de Boston.La plupart des gravures sont imprimées à Rome ou Avignon, et déposées auprès d’un marchand parisien, ou copiées à Paris d’après des modèles italiens. Louise de France, carmélite à Saint-Denis, fait graver l’œuvre de Bley par Etienne Claude Voysard à Paris. Progressivement, les éditeurs prennent quelques libertés dans la représentation du saint. On compte jusqu’à 160 000 portraits différents.Les représentations de saint Benoît-Joseph Labre sont diverses. Il est représenté en petit portrait en buste ou à mi-corps, dans un ovale ou un médaillon, mais aussi debout ou à genoux en prière, bras croisés, yeux baissés. Il est vêtu d’une longue tunique, d’un chapelet autour du cou, avec une écuelle dont l’anse est passée dans la corde autour de sa taille. Certaines gravures françaises dites à compartiments présentent une suite des principaux épisodes de la vie de Labre. Celles-ci ne semblent pas avoir été vendues en Italie.Les archives départementales conservent à la fois les biographies du saint écrites par l’abbé Marconi et J.-B Alegiani traduites en français à la fin du XVIIIe siècle, mais également une version néerlandaise. En effet, aux Pays-Bas et en Allemagne, le culte de saint Benoît-Joseph Labre est prégnant. Le fonds Victor Barbier (4 J) renferme une riche collection d’images pieuses françaises et italiennes du XVIIIe et du XIXe siècles.