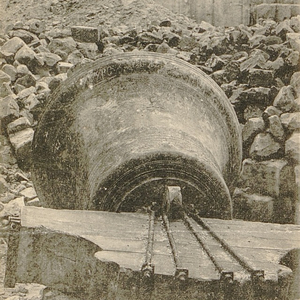Nos cloches sont mortes, mais elles ressusciteront !
Oui ! nous aimions les cloches de la capitale artésienne, quand, aux "jours nataux", c’est-à-dire aux grandes fêtes, elles jetaient vers le ciel leurs joyeux appels, invitant les chrétiens à venir prier le Créateur.
La Révolution ne nous avait laissé que quelques cloches anciennes, notamment la "Salvator". Mais aussitôt la tourmente passée la générosité des bourgeois d’Arras avait repeuplé les clochers relevés de leurs ruines.
L’église de Saint-Nicolas-sur-les-Fossés, préservée du marteau démolisseur par suite de son affectation comme temple de la déesse raison, après avoir été purifiée des souillures jacobines, était devenue cathédrale provisoire sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste jusqu’à l’inauguration en 1833 de la cathédrale qui devait avoir le sort de celle de Reims.
Napoléon, à son passage à Arras, avait décrété l’achèvement de l’imposante chapelle des bénédictins de Saint-Vaast, pour servir de cathédrale.
Sous la Restauration, sur l’emplacement de l’antique et à jamais regrettée cathédrale gothique, l’église de Saint-Nicolas avait surgi. Celle de Saint-Géry fut construite en 1866 par le général architecte Grigny, pour remplacer la chapelle trop exiguë de l’ancienne abbaye des Dames du Vivier aujourd’hui hospice de vieillards.
Non loin de l’emplacement de l’ancienne église Saint-Étienne, Mgr Lequette avait érigé, en 1876, la basilique Notre-Dame-des-Ardents, dont les cloches n’étaient pas moins vibrantes que celles inaugurées à Saint-Jean-Baptiste par le chanoine Gherbrandt.
Outre ces paroisses, le chef-d’œuvre à Arras de Grigny – auteur également de l’élégante flèche et de la chapelle des Ursulines – la chapelle du Saint-Sacrement, si bien restaurée par le vaillant évêque d’Arras et détruite stupidement par les Vandales, avait son délicieux carillon, lançant aux heures et aux demi-heures, son : "Adoremus in aeternum !".
Enfin les cloches des hospices, des orphelinats, des communautés, aujourd’hui muettes, écrasées par les destructeurs de cathédrales, mêlaient leurs voix modestes au grand concert campanaire.
Tout cela n’est plus, il est vrai, qu’un cruel souvenir ! Successivement, avec un acharnement de Boches, les Teutons ont fait taire nos cloches !