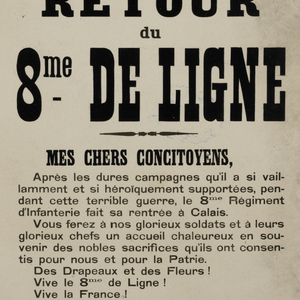Pour nos prisonniers
Les prisonniers rentrent. Suivant le port ou la gare, le débarcadère ou le quai, ils connaissent l'accueil officiel, guindé, mesuré, protocolaire ou l'accueil sympathique, chaud, affectueux d'âmes charitables voulant et sachant délicatement traduire leur gratitude à des martyrs de la guerre.
Aucune de ces manifestations cependant n'échappe au prisonnier quelle que soit sa culture intellectuelle.
Il importe que beaucoup se pénètrent de cette vérité. Le captif qui rentre, après avoir vécu trois ou quatre ans dans les geôles allemandes, est devenu observateur. La plupart du temps c'est un concentré, un renfermé. Il parle peu, il ne découvre plus sa pensée à tout venant. Mais il a, en revanche, contracté l'habitude précieuse de réfléchir davantage. Il observe et se tait. Rien ne lui échappe des moindres mouvements d'autrui. Au débarcadère, sur le quai où il pose le pied en arrivant sur la terre de France, il se trouve dans un monde nouveau qu'il découvre d'un œil rapide et sûr.
Il m'a été rapporté des réflexions, hélas, trop fondées, de ces malheureux à l'occasion du premier repas qu'on leur servait en France. L'accueil qui leur était fait, leur semblait trop corvée mondaine ! Je fais grâce aux lecteurs des commentaires savoureux de ces loques humaines dont la vie abrégée ne sera plus désormais qu'un martyre incessant. Certaines sont cinglantes et je ne vois pas qu'il y ait, pour le bien général, intérêt à publier des remarques trop crues et trop cruelles.
Cependant il ne sera pas mauvais que s'observent ceux qui accepteront, à titre officiel ou privé, l'honneur de recevoir nos prisonniers ; qu'ils apportent, ceux-là, dans leur mission une sympathie si réelle, qu'ils y mettent tout de leur cœur, que leur sincérité ne puisse être mise en doute.
Procéder autrement, afficher un formalisme exagéré, traiter ces grands enfants malades comme certains ronds-de-cuir ont pris l'habitude de traiter leurs victimes – j'entends tous ceux qui, à un titre quelconque, ont dû passer devant leur guichet – serait, à l'heure présente, la dernière des maladresses.
Nos chers captifs en ont assez de la bureaucratie tatillonne et sans entrailles. Beaucoup ont lu nos journaux en captivité. Le ventre creux, l'oreille tendue, les poings serrés, la rage au cœur, groupés silencieux autour du camarade qui, en cachette, faisait à mi-voix la lecture de la feuille passée en fraude, ils ne perdaient pas une miette des nouvelles de France. L'aliment était trop précieux : c'était un peu de l'air de "chez nous" qui leur arrivait aussi.
Et après la lecture le commentaire commençait, provoquant la discussion animée, âpre souvent, car toutes les feuilles arrivaient au camp : celles même qui, en pleine guerre, poussaient à la haine les frères d'armes…
Il est malheureusement des maladresses et des injustices qu'on ne réparera pas de sitôt et qui seront difficilement pardonnées : ce sont celles qu'on a commises contre les familles de ces prisonniers soit comme allocataires militaires, soit comme allocataires réfugiés, évacués ou rapatriés. Les vieux parents, les femmes et les enfants de ces combattants exilés ont été victimes de monstrueuses iniquités. Tandis que le père de famille souffrait de mille tourments dans les bagnes boches, la famille était torturée de privations dans des chambres sans feu, dans des masures inhabitables, car les ressources étaient limitées, comme le pain et le charbon administratifs, au strict minimum !
Voilà ce qu'à leur retour les prisonniers apprendront.
"De quoi l'aîné est-il mort ? Pourquoi les "gosses" n'ont-ils pas mieux "poussés" ?... Où donc as-tu contracté cette toux sèche ?... Pourquoi les champs sont-ils en friche quand il y a tant de prisonniers boches à ne rien faire ?... On ne s'est donc occupé ni de toi ni des petits ?... Quelle fut ta part et le leur dans les centaines de millions de l'assistance officielle ?... Comment as-tu vécu de si peu ?"
L'heure la plus difficile n'a pas sonné. Elle est à venir, lorsque les camps allemands, les mines et les carrières boches auront relâché les victimes échappées à d'incroyables tortures, lorsque seront rentrés ceux qui, hélas, auront accumulé dans leur cœur autre chose que de l'amour et pour qui la patience est devenue une vertu dont on parle, mais qu'on ne pratique plus lorsque la mesure est comble.
N'oublions donc pas les prisonniers qui rentrent. Ils furent, peut-être, trop longtemps loin des yeux, loin hélas de cordiales sincères, fraternelles préoccupations. Mais les voici revenus.
Aidons-les à se refaire une vie. Aidons-les à réparer les injustices dont ils ont, eux et leurs familles, été les victimes. Pansons les plaies avec lesquelles ils reviennent et que peuvent rouvrir la vue des ruines et l'annonce de deuils insoupçonnés. N'attendons, pour le faire, ni leurs appels ni leurs réclamations, car nous risquerions de n'entendre que des clameurs.
Ludovic Rémon